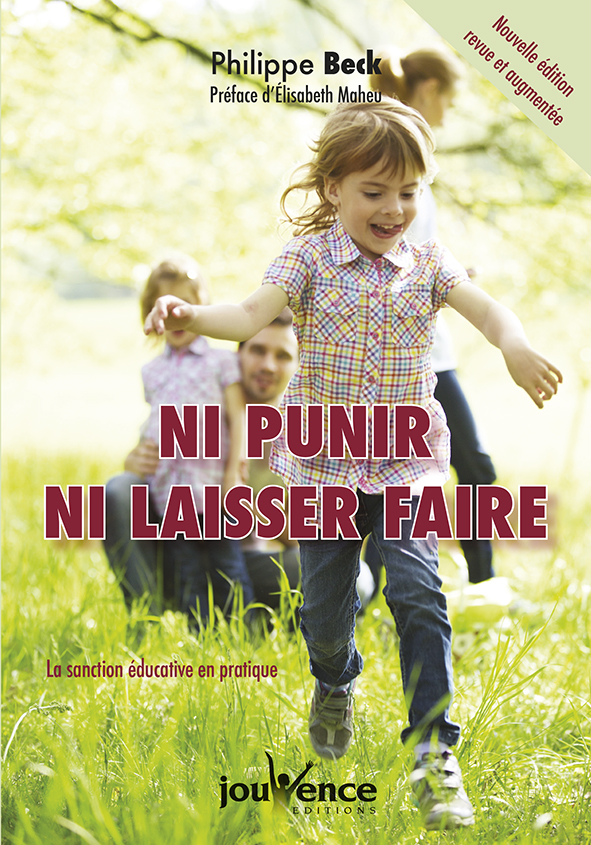De nos jours, les parents ont tendance à être moins stricts avec leurs enfants et à vouloir éviter la punition. Les règles s’assouplissent dans le but de les laisser s’épanouir et apprendre par eux-mêmes. Mais parfois, l’éducation doit passer par la sanction. Comment trouver l’équilibre entre le laxisme et la sévérité ?
La différence entre sanction et punition
Dans le livre Ni punir ni laisser faire (Philippe Beck, Editions Jouvence), on apprend que le mot sanction vient du latin sanctus, qui signifie saint. En effet, le sens profond de la sanction repose sur l’affirmation du caractère “sacré”, inviolable, de la règle concernée. Au contraire, punition vient de punire, soit : châtier, et donc faire souffrir. Dans la sanction, on préfère donc voir l’opportunité de rappeler les règles, de faire réfléchir l’enfant à son acte et de « remettre les points sur les i ». Car même si aucun parent n’a pensé à punir par envie de blesser son enfant, ce dernier en gardera souvent une amertume voire une humiliation qui peut laisser des traces. Parfois, la punition provoque même l’effet inverse en réveillant chez l’enfant (ou plus tard, chez l’adulte), le besoin de se venger et de contrer les règles. La sanction doit, au contraire, ouvrir le dialogue et accompagner l’enfant dans l’apprentissage du bon comportement.
Bien choisir ses sanctions
Il existe 3 types de sanctions :
• La sanction pénale, permet à l’enfant de prendre conscience de l’importance de respecter la règle pour les gens qui l’entourent. Après le rappel de la règle, il peut y avoir privation temporaire d’un droit. Un enfant qui est parti jouer hors du périmètre donné par la maîtresse peut voir sa zone de jeu être plus limitée pour un temps, par exemple.
• La sanction civile a pour but de réparer les dégâts et/ou de dédommager la personne touchée si besoin. Elle permet de restituer le lien entre le transgresseur et la ou les victimes. Par exemple, on pourra demander à un enfant qui a peint sur les murs de l’école d’aider le concierge à nettoyer les locaux salis.
• Enfin, la sanction personnelle, va faire comprendre à l’enfant l’utilité de la règle pour lui-même. Il peut simplement être amené à réfléchir sur ce qu’il a fait et à mettre en place ce qu’il faut pour ne pas que ça se reproduise. Pourquoi ne pas lui demander de mettre des mots sur son ressenti et les alternatives acceptables (pour les plus petits) ? Ou d’inventer une histoire où il met en scène la dérogation à la règle (à partir de 6 ans…) ?
Selon la transgression commise, ces 3 types de sanctions peuvent être appliquées, ou non. Ayez toujours à l’esprit que l’enfant doit apprendre de ses erreurs, et bien évidemment, se doit de dédommager les victimes (s’il y en a). Cela lui permettra, par la même occasion, de prendre conscience de ses responsabilités.
Attention aussi à ne pas discréditer une tâche (faire la vaisselle, éplucher les pommes de terre…) en s’en servant comme sanction, surtout si celle-ci s’inscrit dans votre quotidien.
En amenant le dialogue avec l’enfant et en le sanctionnant de façon réfléchie et constructive, on l’aide à grandir en évitant la violence. Bien sûr, quand la règle n’est pas applicable car trop difficile à tenir pour un enfant, il faut la changer et l’adapter.
Elodie Gindrier